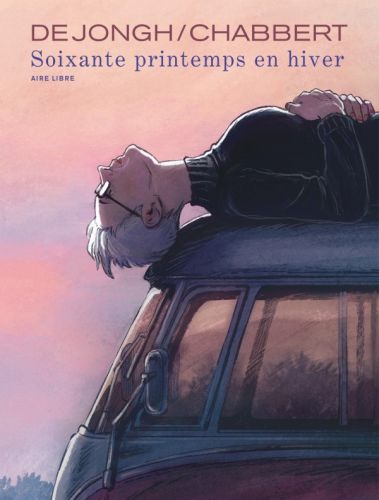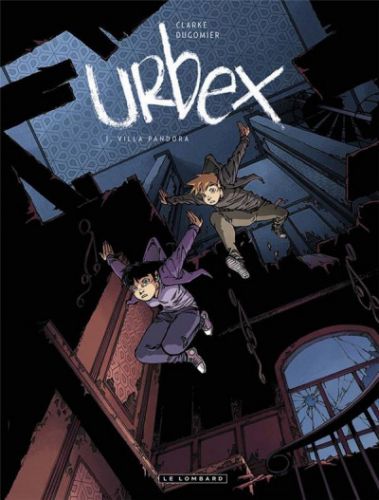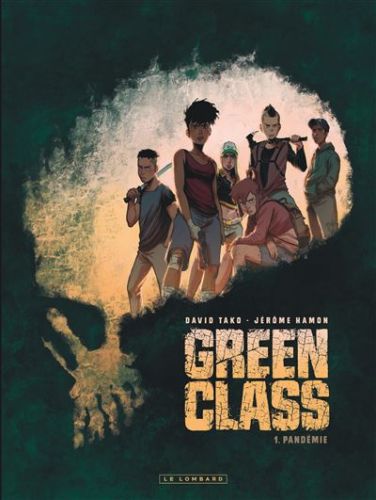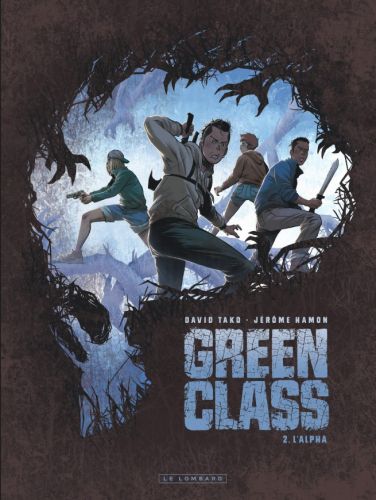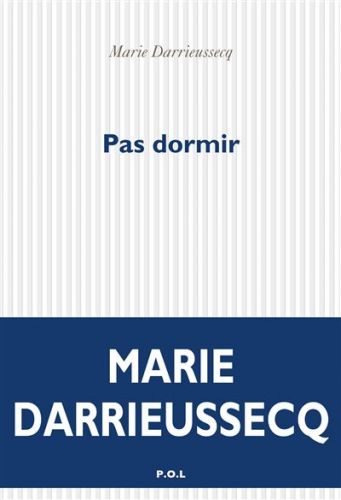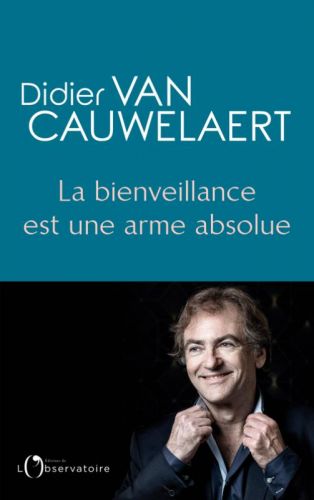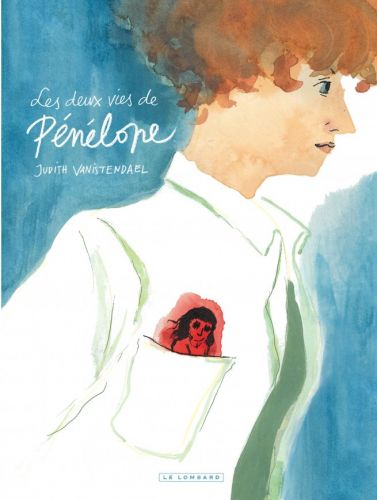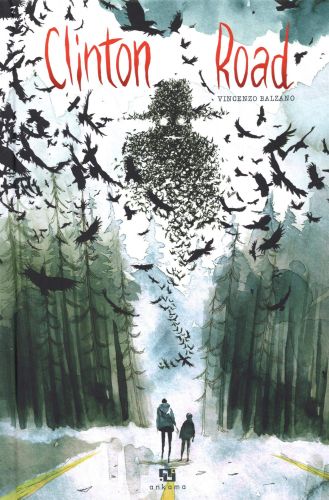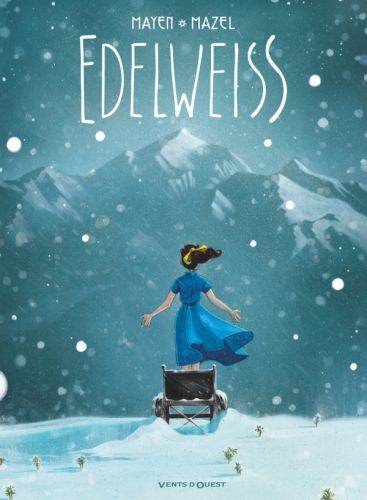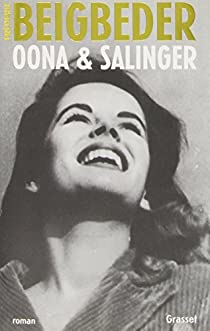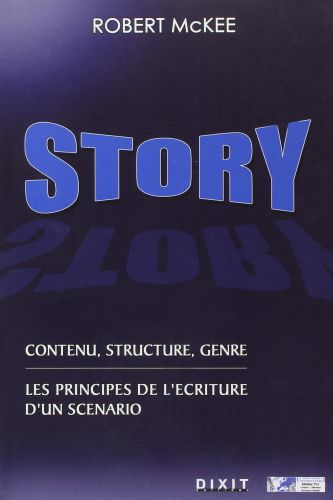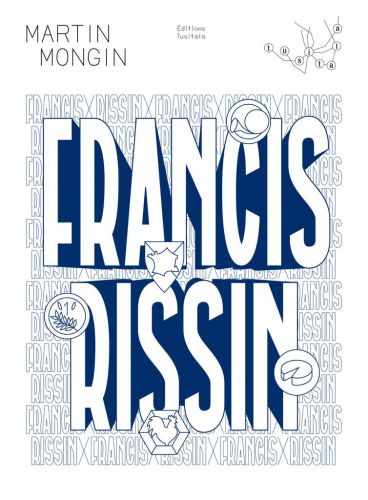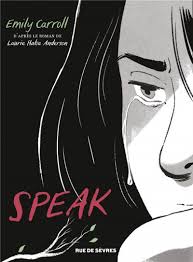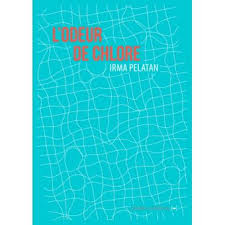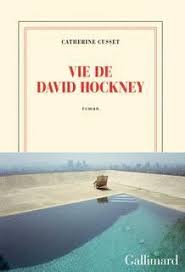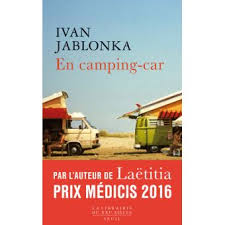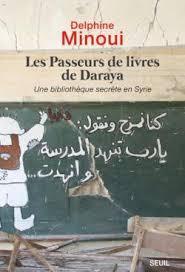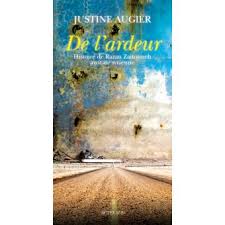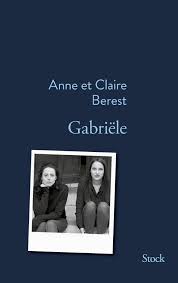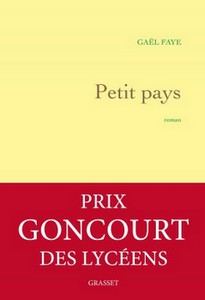Avril 1994. Au Rwanda, une guerre ethnique
oppose les Hutus aux Tutsis, faisant 800 000 morts, principalement Tutsis. "Zouzou"
a 14 ans à l'époque. Elle voit sa mère se faire tuer sous ses yeux avant que
son corps ne soit livré aux chiens ; sa sœur et son petit frère sont massacrés
à coups de machette. Elle échappe à la tuerie avec son autre sœur qui est,
elle, gravement blessée. Elle perdra au cours des jours suivants d'autres
membres de sa famille, tués de façon tout aussi épouvantable.
Il est évident qu'il faut raconter, parler.
Parler de ces morts, qu'elle appelle "Mes quelqu'uns", qu'elle n'a
jamais vus puisqu'ils ont été – au mieux –jetés dans une fosse commune. Parler
pour continuer à vivre, avec ses fantômes et ses souvenirs. Comment s'y prendre
? Comment faire son deuil sans sépulture auprès de laquelle se recueillir ? Comment
dire à ses propres enfants la façon dont ses parents sont morts sans leur
cacher sa peine, et quoi taire ? Ces interrogations sont en filigrane tout au
long de ce récit évidemment terrible et émouvant.
Cependant, le choix de l'auteur de raconter
ses souvenirs de façon déconstruite, en passant de son arrivée en France au
présent de sa vie avec son mari et ses deux enfants, des épisodes de son
enfance au le récit du massacre, rendent le récit décousu et parfois confus :
le lecteur se perd dans la chronologie. Par ailleurs le style est assez
ordinaire, voire parfois relâché (lors de l'épisode de la rencontre avec les
parents de Raphaël par exemple).
Enfin, il y a l'horreur. Des massacres, mais
aussi de leurs conséquences. Huit ans après le génocide, l'auteur rencontre les
tueurs, qu'elle a vus s'acharner sur sa tante, son oncle et leurs enfants. Elle
discute "à la façon rwandaise", chacun sachant que l'autre sait qui
il est. C'est une situation absolument incompréhensible pour nous, européens :
comment peut-on converser avec les assassins de sa famille, qu'ils ont tuée si
sauvagement, alors qu'ils reconnaissent la qualité des défunts, et même s'interrogent
à voix haute sur les raisons de ce carnage ? Comment peut-on accepter que leurs
femmes portent les vêtements de sa tante et de ses cousines massacrées ?
Comment peut-on accepter de jouer le jeu à ce point ? De les entendre dire par
exemple, p.135 : "Pour les empêcher de fuir, il a fallu leur couper les
tendons. Ensuite, il a été clair que ce n'était pas la peine de les achever,
elles finiraient par se vider de leur sang…" Insupportable. De même, une
jeune guide enceinte fait visiter une église transformée en musée, en face
duquel elle vit… à côté des tueurs Hutus qui ont exterminé sa famille.
On se demande même s'il n'y a pas une sorte
de complaisance à vivre dans le souvenir des morts : "Je me dois d'être sa
tombe, aussi longtemps que ses os traîneront quelque part sur ces collines.
Vivante, elle m'a portée dans son ventre, elle m'a nourrie de son sein, elle
m'a portée sur son dos, elle m'a aimée. Morte, je la porterai, dans mon ventre,
sur mon dos.", écrit l'auteur p.113.
Enfin, contrairement à l'ensemble du récit,
sa dernière partie évoque en détail le soir du massacre – comme s'il avait
fallu toutes ces pages et ces allers-retours entre présent et passé pour qu'Annick
Kayitesi-Jozan puisse enfin raconter entièrement et s'alléger un peu. Mais son
témoignage est devenu une sorte de thérapie : la démarche trouve là ses
limites.

Catégorie : Divers
autobiographie / guerre / Afrique /